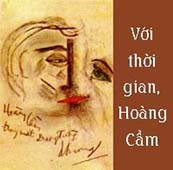Phùng Quán - Bonnes Feuilles
Phùng Quán
Un
poète se
raconte
Textes
choisis, traduits
du viêtnamien et annotés par
Frédéric Pham,
editions-harmattan
Bonnes feuilles
Tome I : sur le chemin du vrai
L'exclu
(…)
J’ai fait cuire le riz, frire le poisson, bouillir le bouillon aigre. Nous nous sommes assis pour manger près du feu.
– Si l’on y réfléchit bien, dans toute infortune on peut trouver quelque chose d’heureux, dit Tuân. C’est peut-être grâce à cela que l’être humain peut survivre dans les situations les plus dures.
– Dis-moi voir, qu’est-ce que tu as pu trouver d’heureux pendant ces dix ans ? lui demandai-je.
– Avant tout, j’ai pu méditer davantage sur mon projet de roman, dont j’ai déjà écrit les deux premiers chapitres, comme tu sais. Cette expérience de dix ans m’a montré que le contenu de mon roman était trop gentillet, trop superficiel. Selon moi, sans ses dix ans de déportation en Sibérie, le talent de Dostoïevski n’aurait pas atteint un tel niveau. Je crois que si je le réécris, mon roman sera bien meilleur, bien plus profond. Ce sera mon Souvenirs de la maison des morts à moi. Par ailleurs, ces dix ans m’ont permis d’apprendre le russe tout seul. Maintenant je peux lire Dostoïevski dans le texte. Mais dans tout ce qui m’est arrivé d’heureux, voilà le plus important : pendant ces dix ans j’ai vécu parmi des êtres infiniment riches et complexes, un matériau vivant en or pour un écrivain. Je vais simplement te parler de l’un d’entre eux…
«… Il était entré au camp assez longtemps avant moi, je ne sais pas pour quel délit. Certains parlaient de crime de droit commun, d’autres de crime politique. Mais l’un comme l’autre me paraissait difficile à croire. Il n’avait pas l’allure d’un voleur ou d’un assassin, ni les manières de quelqu’un qui fait de la politique. Il avait l’air d’un idiot, un simplet, un fada. Il me faisait penser à un morceau de bois à la dérive, arraché à un coin de forêt par une tempête, et qui flottant à travers le camp avait été arrêté par la barrière et était resté coincé là. A le voir on avait beaucoup de mal à deviner son âge, peut-être trente ans, peut-être cinquante. Son visage était rabougri, fripé, flétri comme un sac en osier déchiré abandonné sur un tas d’ordures. Son corps efflanqué, ses membres raides, couleur de suie, n’étaient que peau, os et tendons. Sur lui, il portait par tous les temps un tas de loques lui servant de vêtements. Au début je le croyais muet, car de toute la journée je le voyais rarement ouvrir la bouche si ce n’est pour sourire du bout des lèvres. En fait, c’était simplement quelqu’un qui parlait très peu. Quand il rencontrait quelqu’un dans le camp, qu’il s’agisse d’un surveillant ou d’un condamné, il s’inclinait pour saluer avec déférence, mais il ne bavardait avec personne. Et pourtant, inexplicablement, quelque chose en lui attirait l’attention, donnait envie de faire connaissance… J’ai souvent voulu engager la conversation, mais il me regardait d’un regard très étrange, et puis il s’esquivait après s’être incliné pour me saluer avec déférence. Presque tous au camp l’aimaient, même les plus méchants. Quand des prisonniers avaient la visite de leurs familles, ils lui mettaient de côté qui un bonbon, qui une part de gâteau, parfois une cigarette. Au camp il avait un privilège que personne ne lui disputait, et que personne ne voulait lui disputer : celui d’ensevelir les prisonniers morts. Chaque fois qu’un prisonnier mourait, les surveillants faisaient toujours appel au « fada » (comme ils l’appelaient) pour lui dire de l’ensevelir. Chaque détenu mort, même ceux qui l’avaient parfois brutalisé, il en prenait soin avec une égale perfection. Il faisait chauffer une infusion de feuilles sauvages, lavait le mort avec, frottait avec soin la crasse du corps glacé et raidi, avec les mains d’une mère lavant son tout petit enfant. Quand il lavait, quand il frottait, on voyait sa bouche remuer et dire des choses que personne n’entendait distinctement. Sortant de sa poche de veste un bout de peigne cassé, il en peignait le mort si celui-ci avait des cheveux. Il choisissait le costume le plus présentable du prisonnier et, l’en ayant habillé, soulevait délicatement le corps pour le mettre dans le cercueil fait de bois grossier. Il enroulait les autres vêtements pour en faire un paquet bien net, qu’il mettait sous la tête du mort en guise d’oreiller. Si le prisonnier n’avait pas d’autres vêtements, il équarrissait un morceau de bois pour en faire un oreiller. Quand il avait terminé ces besognes, il s’agenouillait à côté du cercueil, se baissait pour embrasser le mort sur le front, et se mettait à pleurer. Il pleurait de façon si douloureuse et si pathétique que tout le monde avait l’impression que la personne gisant dans le cercueil était le propre frère du pleureur. Et avec n’importe quel prisonnier il pleurait de cette même façon. Un jour, le surveillant l’avait convoqué :
– Qu’est-ce qu’il était pour toi, ce prisonnier qui est mort, que tu le pleures comme si c’était ton père ?
Il avait joint les mains et répondu en s’inclinant profondément :
– Monsieur le surveillant, je fais semblant de pleurer. Si un mort n’est pas accompagné par le son des pleurs, son âme n’arrêtera pas de tournoyer dans le camp. Peut-être qu’elle va trouver moyen de vous faire du mal. Tant que ce type vivait, vous pouviez le punir, mais maintenant que c’est son âme, si vous voulez l’enchaîner par le cou il n’y aura pas moyen.
Ce que disait le fada était raisonnable. Le surveillant se dit : laissons faire, qu’il pleure tant qu’il veut. Mais moi je ne crois pas qu’il faisait semblant de pleurer. Quand il pleurait, tout son visage jaunâtre et ridé était baigné de larmes. Tout son corps osseux était agité de tremblements. J’avais l’impression que même le tas de loques qu’il portait sur lui pleurait aussi… Dans le son de ses pleurs et dans ses larmes on sentait déborder une compassion difficile à décrire. En l’entendant pleurer, même les détenus notoirement obstinés et endurcis, « tête de pilon, cul de billot, figure de boulon » y allaient de leur petite goutte. Seule une douleur véritable peut ainsi pénétrer droit dans le coeur des hommes.
Je me posais beaucoup de questions sur lui. Qui était-il ? Un fada, ou bien un être doté de la vraie compassion des grands sages ?... Et ne voilà-t-il pas qu’un jour, lui et moi sommes allés mener les buffles se baigner à la rivière près du camp. Il faisait chaud comme sous une douche de feu. La plage de sable et de galets était brûlante comme un brasier ardent. Au-dessus de la plage poussait, solitaire, un vieil arbre au tronc rugueux, dont le feuillage étique projetait une ombre de la taille d’une natte individuelle sur le sable et les galets. Notre sentinelle était assise avec son fusil au-dessus de la berge escarpée, se protégeant du soleil sous un buisson. Mon compagnon et moi devions nous protéger du soleil sous l’arbre, à côté du troupeau de buffles qui s’ébattait sous l’eau. L’ombre était si mince que nous étions presque dos à dos. Il parla le premier, me demandant sans tourner la tête :
– Dis donc, Tuân (je ne sais pas depuis quand il connaissait mon nom), dans ta vie ici, qu’est-ce qui te manque le plus ?
(…)
pp. 201 à 204.
Tome II : ami, je veux t’inviter chez moi
Comment je suis devenu écrivain
(…)
Tandis que les tempêtes de la mousson du nord-est soufflaient en rafales sur Hanoi, que les amandiers et les arbres à riz froid6 le long des rues n’étaient plus que squelettes décharnés, tandis que les brouillards du soir assombrissaient le ciel, que les bộ đội hommes et femmes portaient des vestes de duvet et s’enveloppaient de couvertures molletonnées, j’écrivis le point final de ma première oeuvre. J’étais un vrai squelette, en me regardant dans la glace je voyais un visage verdâtre. Je me mis à lire et à relire mon oeuvre, et il m’apparut soudain que je devais tout récrire depuis le début. Mais j’étais alors au bout de mes forces. J’avais la sensation d’être un verre d’eau empli jusqu’au bord de forces de vie, et dont toute l’eau s’était déversée dans mes pages d’écriture, vidant le verre jusqu’au fond. C’était une sensation tout à fait matérielle. La sensation très concrète, comme visible à l’oeil nu, d’être vidé de ma force intérieure.
Ce jour-là, après le repas de midi, j’apportai mon manuscrit à la salle de travail. Vũ Tú Nam était assis à la table, en train de boire du thé. Je savais qu’après le repas il prenait toujours une quinzaine de minutes de repos en buvant du thé, avant d’aller faire la sieste. Je posai timidement mon manuscrit devant ses yeux, et dis très doucement :
– Le travail que vous m’avez confié, je l’ai fini.
Le manuscrit faisait plus de 200 pages, six rames de feuilles Hoàng Văn Thụ remplies d’une écriture serrée, à l’encre. J’avais utilisé une aiguille et du fil pour les relier ensemble. A l’extérieur j’avais collé une couverture verte. Je regardai à nouveau le résultat de mon labeur de plus d’un mois, et ressentis quand même un brin de fierté : vraiment, je ne me serais pas cru capable d’écrire tant de mots.
Vũ Tú Nam regarda la couverture et dit :
– Il ne faut pas écrire « Chuyện Dài » (histoire longue) mais « Truyện Dài », les histoires qu’on raconte c’est Chuyện mais celles qu’on écrit c’est Truyện. Il feuilleta les pages du manuscrit, hochant doucement la tête : tu as écrit drôlement vite !
– J’ai essayé de ne pas gaspiller mon temps, dis-je, de peur que la Division me reproche de m’attarder trop à Hanoi. Vous pourriez peut-être… J’hésitai à poursuivre : …m’écrire un ordre de mission pour que je retourne à la division.
– Ne t’en fais pas, dit-il. La Division a déjà répondu officiellement à la Section de Propagande et d’Idéologie, elle est d’accord pour que tu restes jusqu’à ce que tu aies fini d’écrire ton histoire. Je vais la lire et te donner mon opinion, puis je proposerai au Service de décider que tu restes pour faire les corrections nécessaires, ou bien que tu retournes à la division.
En l’entendant parler ainsi, je ne sais pourquoi je me sentis soudain envahi par une tristesse qui me mordait les entrailles. La tristesse de me dire que sûrement j’allais subir un échec lamentable. Je me demandais avec inquiétude si ces lignes d’écriture serrée dont j’avais couvert ces feuilles de papier valaient la peine qu’un écrivain célèbre comme lui perde son temps à les lire. Ou bien il devra se forcer à les lire, par pitié pour son petit frère combattant qui s’est donné le mal de les écrire.
Soudain m’apparut la longue route interminable qui me ramènerait de Hanoi à la division. Le sac sur le dos, mon sac à riz autour du ventre, je devrais tristement me traîner seul sur la route, marchant le jour dormant la nuit. C’était horrible d’y penser. En allant à pied à Hanoi j’étais tout excité à l’idée de voir toute la ville mobilisée. Sur le chemin du retour, il n’y aurait que la fatigue de la route interminable, et rien en main que l’échec.
Mes lèvres se mirent à trembler.
– Permettez-moi d’aller faire un somme, dis-je. J’ai terriblement sommeil.
Il me répondit d’une voix pleine d’affection :
– Bien sûr ! Va dormir, Quán, dors jusqu’au soir pour reprendre des forces. Ces temps-ci tu as vraiment trop mauvaise mine.
6 Un arbre à fleurs blanches, très parfumé
(…)
pp. 66 à 68.
Le vieil homme
(…)
Je riais franchement, mis en joie par les quelques tasses d’alcool qu’il venait de me verser. Mais lui ne riait pas, il plissait un peu le front en me fixant des yeux.
– Beuh, qu’est-ce que tu as à me regarder comme ça, que ça fait peur ?
Pour éviter ce regard impénétrable, j’ai pris la bouteille et m’en suis versé un plein verre, que j’ai sifflé jusqu’au fond. Et alors la tête a commencé à me tourner. Il s’est baissé soudain pour regarder le sol de ciment où des fourmis noires ayant flairé l’odeur de nourriture couraient de droite et de gauche. Et il m’a demandé sans relever la tête, avec une voix au timbre très familier, mais très étrange :
– Ces poésies que tu as faites là, tu les trouves vraiment futiles, n’est-ce pas ?
Ça m’est revenu ! Ce timbre de voix, c’était celui d’il y a quarante ans, quand il s’était penché pour me déposer sur la lande de sable de Phong Chương et avait péniblement déchiré le morceau le moins sale de sa manche de veste, en me demandant : « Est-ce que ça fait très mal ? »
Le son du rire s’est soudain étouffé sur mes lèvres. Je me suis baissé aussi pour regarder les fourmis qui couraient en tous sens.
– Il n’y a pas si longtemps, je considérais toujours ça comme une chose infiniment sérieuse… Et tu sais bien, les soldats de ta génération et de la mienne, quand on considère une chose comme sérieuse, on est prêt à mourir pour elle.
(…)
pp. 148-149.
Các thao tác trên Tài liệu