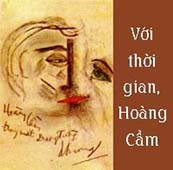Retour au Vietnam
Retour au Vietnami
Nguyễn Quang
Để tưởng nhớ nhà văn Nguyễn Quang Thân (từ trần ngày 4.3.2017), chúng tôi đăng lại bài của Nguyễn Quang (em họ nhà văn). Bài này đăng lần đầu trên báo Đoàn Kết (số 376, 377, 378, tháng 1, 2, 3.1986), "Cousin Thân" xuyên suốt trong bài chính là nhà văn Nguyễn Quang Thân.
Le retour de l’enfant prodigue
À Vinh, après le Têt
« Pour voyager au Vietnam », m’a dit mon cousin Thân, qui fait profession d’écrivain et, à ce titre, ne s’exprime pas comme le commun des mortels, « il faut savoir marier l’art à la science : l’art, c’est de frapper aux bons guichets, la science, c’est de chiader les correspondances. Fais tienne la vieille maxime : “Connais-toi toi-même, connais l’ennemi, et chacun de tes combats sera une victoire.” Et si malgré tout ça ne marche pas, eh bien ! dis-toi que tu es au Vietnam, un pays où tout peut arriver. » C’est justement ce que je suis en train de me dire, en rade sur la route de Hà Nội à Vinh, à peine au quart du chemin, alors que la journée est déjà bien avancée et que le chef de notre “expédition”, Mme C., se répand en imprécations contre la race des “chauffeurs-bureaucrates” qui, selon elle, devrait être rayée de la surface de la terre. Mais récapitulons.
Après un Tết tristounet et froid passé à Hanoi, je devais me rendre impérativement aux environs de Vinh, à 200 km dans le sud, afin d’assister au giỗ de mon oncle (cérémonie familiale en commémoration d’un mort). Une expédition précédente par le train, quelques années auparavant, douze heures passées debout entassé avec dix compagnons d’infortune dans l’étroit espace séparant deux compartiments, m’avait laissé un souvenir terrifié. Aussi, cette fois-ci, étais-je décidé à mettre en pratique les recettes du cousin Thân. J’avais frappé au bon guichet, à savoir chez Mme C., qui devait justement se rendre à Vinh avec sa voiture de fonction : une forte femme, cette Mme C., vice-directrice de l’École du Parti et tout ça, et en plus c’était une “tante” à moi, à la mode vietnamienne (cô, dì, o, mu, thím… je m’y perds complètement). J’avais chiadé mes correspondances : de Hanoi à Vinh, pause à Vinh chez un bác (oncle aîné), puis de Vinh à Huong Son, au village de ma famille, pour le giô du chú (oncle cadet). Mais j’avais sous-estimé un adversaire redoutable : le représentant des “chauffeurs-bureaucrates”.
Rendez-vous était pris pour 5 h 30 du matin. La voiture n’arrive qu’à 10 h 30. Normal. C’est un command-car, une sorte de Jeep fabriquée en Roumanie. Il était prévu six passagers. Nous nous retrouvons à douze, entassés pêle-mêle avec un énorme fût d’essence de 200 litres qui mange la moitié de notre espace vital, deux sacs de riz, une bicyclette attachée au pare-chocs arrière, trois paniers par ci, quatre corbeilles par là… Normal. Je me retrouve “assis” sur le bout du bout d’une banquette, coincé contre le fût d’essence, les jambes pendant à l’extérieur à travers le cadre de la bicyclette. Si je pouvais à la fois me tourner à droite (pour éviter le fût) et à gauche (pour mes jambes), ce serait parfait. Normal. Mon vis-à-vis, qui partage avec moi le privilège de passer les jambes à l’extérieur, est un étudiant en chimie, et aussi l’heureux propriétaire de la bicyclette. « Propriétaire, oui, me dit-il, mais à chaque fois que mon vélo crie bobo, c’est moi qui crie à mes parents : “Au secours !” Chimiste ou pas, l’entretien d’une bicyclette est au-dessus de mes moyens. » Justement, il se rend à Vinh pour passer quelques jours dans sa famille, à l’occasion du Têt comme pratiquement tous les passagers de la Jeep, à commencer par moi-même.
Donc, la journée est déjà bien avancée et nous ne sommes qu’à une cinquantaine de kilomètres de Hanoi quand le pneu arrière gauche rend l’âme. Le chauffeur a une réaction surprenante. Il range la voiture sur le bord de la route, s’assied à croupetons à côté du pneu incriminé… et regarde passer les oiseaux.
Au bout d’un certain temps, quelqu’un suggère quand même :
« Et si l’on sortait la roue de secours ?
Je n’en ai pas », répond le chauffeur. Ah ! Voilà qui change les données du problème. Après conciliabule, il est décidé qu’on va détacher la précieuse bicyclette, pédaler avec le pneu crevé jusqu’au village le plus proche, le faire réparer, revenir en pédalant. Le chimiste est tout fier. Pas pour longtemps.
« Je n’ai pas de cric », dit le chauffeur. C’est là que Mme C. éclate. Il faut dire qu’au pays, les chauffeurs ont une réputation terrible. Ils n’ont de compte à rendre qu’à leur voiture, pour ainsi dire. L’utilisateur de la voiture, si haut placé soit-il, a intérêt à être bien avec son chauffeur (comme en France on a intérêt à être bien avec son concierge), sinon, inexplicablement, la machine tombe en panne, les embouteillages se multiplient, etc., tous phénomènes que la sagesse populaire a intégrés dans une formule profonde : « Les autos ne marchent pas à l’essence, mais au riz sucré et au vin (xôi ruou). » Quoi qu’il en soit, nous voilà bel et bien en panne. Nous essayons de héler quelques cars, qui passent en nous ignorant superbement. « La solidarité n’est plus ce qu’elle était », grommelle Mme C. (ou quelque chose dans le genre). Le Bon Samaritain finit quand même par se manifester : c’est le chauffeur d’un autre command-car (confrérie oblige) qui nous prête et une roue, et un cric. Au village le plus proche, le réparateur de vélos, qui est également le cafetier du coin, non content de réparer la chambre avec des rustines, redonne également un coup de neuf à la carcasse du pneu en recousant les endroits suspects avec du fil et une aiguille. Puis il regonfle le tout avec une pompe à vélo (une grande pompe, mais c’est quand même une pompe à vélo).
Notre voyage se poursuit dans les cahots. Des sardines dans une boîte à conserve sont aussi entassées que nous, mais certainement moins secouées. Mon voisin immédiat verdit dans son mouchoir. Mon vis-à-vis, le chimiste, se penche au dehors pour vomir tripes et boyaux. Quant à moi, je ne compte plus mes crampes. C’est bien le voyage le plus terrible que j’aie jamais fait. J’ai une bonne raison pour aller à Vinh mais, à ce que je sais, pour les autres passagers, il s’agit simplement de rentrer pour quelques jours dans leur village. Que de temps perdu, que d’efforts consentis, que de peine endurée pour ces quelques jours de vacances ! En toutes saisons et en tout point du globe, on ne peut que s’étonner de cet élan irrépressible qui pousse le Vietnamien vers son petit coin de terre ancestraleii. Moi-même, le Viêt kiêu plus ou moins occidentalisé, je le ressens, même affaibli. N’est-ce pas là une des composantes essentielles de l’âme vietnanienne et partant, de l’Histoire vietnamienne ? Autant de spéculations philosophiques qui m’aident à oublier le froid, les cahots, les courbatures, comme nous progressons cahin-caha vers Vinh dans le soir qui descend.
Il est neuf heures du soir et nous sommes enfin à Vinh. L’électricité est coupée, ce qui accentue encore la désolation d’une nuit d’hiver chargée de nuages. Mon oncle aîné habite à la périphérie de la ville, dans un coin qui est déjà la campagne. De nuit, il n’est guère recommandé de s’y rendre en voiture, sous peine de se retrouver dans un champ ou dans un étang. Aussi y allons-nous à pied, Mme C. et moi. Randonnée surréaliste, dans la vague phosphorescence du ciel et des eaux, dans le crissement du silence rompu seulement par les hurlements des chiens qui se déchaînent sur notre passage. De temps à autre, ombres surgissant de l’ombre, des cyclistes nous croisent ou nous dépassent. Ils pédalent absolument sans aucune lumière — seuls les trahissent, quand ils approchent, le chuintement des pneus sur le gravier ou le murmure étouffé d’une conversation. Comme je m’étonne de cette circulation dans l’ombre (je suis déjà rentré dans un énorme tas de détritus et un nombre indéterminé de choses innommables), Mme C. me dit : « Bah ! Quand deux tortues s’embrassent, on ne peut pas parler d’accident. » Réflexion pertinente.
Après ce qui me semble mille tours et détours à travers la campagne, Mme C. me prévient, à des signes connus d’elle seule, que nous approchons du but. Au croassement des grenouilles, au friselis du vent, je devine à ma gauche un étang ; à ma droite, une haie de bambous qui laisse filtrer quelques lucioles rouges — les flammèches des lampes à pétrole qu’on a allumées dans toute la maison pour nous guider. À la porte du jardin, ma cousine Nhân nous accueille avec un soulagement visible. Manifestement, tout le monde voyait déjà le précieux neveu perdu corps et biens au fin fond de la province. Nhân avait même accroché son hamac à l’entrée pour nous attendre.
Ah ! ma cousine Nhân… C’est, comme qui dirait, ma cousine préférée. Selon les canons de la beauté vietnamienne :
[Nhân]
xem trang trọng khác vời,
Khuôn
trăng đầy đặn nét ngài nở nang.
Hoa
cười ngọc thốt đoan trang,
Mây
thua nước tóc tuyết nhường màu da.
Elle étudie les langues étrangères à Hanoi, et les allées de l’université sont jonchées des espoirs déçus de ses soupirants — dont le chimiste à la bicyclette de ce matin. Son prochain départ (ce sont ses dernières vacances à Vinh) pour la lointaine Minsk laissera plus d’un éclopé du cœur.
Ma cousine de Hương Sơn
Après être passé, comme un relais dans une course, des mains de Mme C. à celles de ma cousine Nhân, je dois me rendre ce matin à Huong Son. Ce n’est qu’à trente kilomètres d’ici, mais vu les difficultés de transport, ce pourrait être à trente années-lumière. Il faut prendre un car jusqu’à un bac, puis de là pédaler (ou patauger, s’il pleut) jusqu’au village. Le plus difficile est encore de prendre le car, les billets étant comme d’habitude introuvables. Vu mes épreuves de la veille, on me laisse royalement dormir jusqu’à sept heures. À huit heures, je me rends en bicyclette avec Nhân à la gare routière de Vinh pour prendre le second car de la journée. Le premier est parti “à cinq heures”, celui-ci doit partir “à neuf heures”. Les horaires sont entre guillemets et au conditionnel parce que, selon l’habitude vietnamienne, les cars ne démarrent qu’après avoir fait le plein absolu de voyageurs. « Pour rentabiliser l’essence au maximum », me dit Nhân. Argument qui paraît raisonnable au premier abord, mais qui ne résiste pas à l’examen : en effet, puisque la demande de places dépasse largement l’offre (surtout aux alentours du Têt, où la bougeotte des Vietnamiens devient une frénésie), les cars ont la certitude d’être remplis ; il suffirait qu’ils partent à l’heure fixée pour qu’après une ou deux fois, les voyageurs apprennent à ne pas arriver en retard. Enfin…
Comme d’autres passagers matinaux, nous montons dans notre car, Nhân et moi, pour “l’aider à se remplir”. Autour de nous, c’est une véritable corrida, sur une grande place entourée d’un mur bas, avec une cinquantaine de cars parqués, d’autres qui manœuvrent, entrent et sortent, klaxonnant au milieu d’une foule braillarde et indisciplinée. L’existence de la gare routière, jointe à celle de la gare tout court, montre que Vinh est vraiment un nœud vital dans la circulation du Vietnam, point de distribution indispensable dans la partie étranglée du pays, ce goulot central où se croisent et se bousculent les flots de véhicules et de voyageurs déversés par les entonnoirs opposés du Nord et du Sud. C’est à son titre de nœud routier et ferroviaire d’ailleurs que la ville de Vinh doit l’“honneur” d’avoir été, pendant la guerre, rasée et re-rasée quatre fois de suite par les bombardiers de l’US Air Force.
Pour passer le temps, nous lions conversation avec les autres passagers. Nhân semble connaître pas mal de monde dans le coin. Rien de plus naturel, m’explique-t-elle, car elle a passé son enfance à traîner dans les parages après que sa famille — la mienne — eut été chassée de Huong Son par les excès de la réforme agraire. La “terreur rouge” de 1956… Les gens d’ici en parlent encore avec des trémolos dans la voix. Sur cette terre du Nghệ Tĩnh, deux provinces jumelées dans la pauvreté, berceau de toutes les jacqueries et de toutes les révolutions, la roue de l’Histoire, quand elle est passée, a tout écrasé sur son passage. Sur les décombres de l’Ancien Monde, un nouvel ordre des choses est né, enfanté dans le tumulte et les convulsions. C’était le temps des tribunaux populaires et de l’ultramaoïsme. Les prisons étaient peuplées essentiellement de ci-devant địa chủ (propriétaires fonciers)… et de cadres du Parti, envoyés par Hanoi mais jugés “révisionnistes” par les comités locaux.
« Dans notre famille, m’explique Nhân, il y avait des gens des deux bords, địa chủ et cadres du Parti [comme dans toutes les familles, finalement], mais tous se sont retrouvés dans le même sac. Avec ton père à Saigon [parti faire des études, il s’était retrouvé coincé dans le Sud], mon propre père à Hanoi, ma mère en prison, nos grands-parents décédés, nous nous sommes retrouvés, nous les enfants, livrés à nous-mêmes. Thân [le futur écrivain, eh oui !], l’aîné de la famille, en était devenu le chef théorique, mais c’est ma sœur aînée, chi Hoa, qui “tenait la baraque”. Elle faisait toutes sortes de commerces. Je me souviens — essentiellement à cause de la bonne odeur et de la chaleur du feu — que l’hiver nous fabriquions et vendions des nougats aux cacahuètes. Je traînais autour de la gare routière, avec sur les épaules un embryon de chandail qui croissait par à-coups, au fur et à mesure que chi Hoa trouvait l’argent pour acheter de la laine et le temps pour la tricoter… Ah, chi Hoa ! Je “m’aplatis d’admiration” (phục sát đất) quand je pense à elle. Après la réforme agraire, elle a écrit un poème, intitulé Deux moissons : la première moisson, c’est celle qu’elle suivait en spectatrice, assise à l’ombre des arbres avec une domestique qui l’éventait et lui servait des rafraîchissements ; la seconde, c’est quand elle-même se retrouvait dans la rizière, dos courbé sous le soleil, mains écorchées par le paddy, luttant pour sa survie… Quelle chute, tu ne trouves pas ? Nous habitions des maisons de briques à toits de tuiles, les paysans dans des paillottes percées. Nous couchions sur des lits en bois de teck, ils s’enroulaient, selon leur propre expression, dans une demi-natte de paille pour l’hiver. Nous vivions entre nous, passant d’une maison à l’autre en passant d’un jardin à l’autre, nous leur laissions les sentiers pour patauger et les rizières pour labourer. Et si nous nous mêlions parfois à eux, c’était les soirs de grande crue, quand nous allions nous promener en barque au clair de lune, au-dessus des champs inondés, pendant qu’ils déménageaient leurs maigres affaires sur les toits de leurs chaumières… Mais ce monde-là n’est plus, Hương Sơn la belleiii n’est plus, les maisons ont été démolies, les vergers abattus, et notre famille a dégringolé de son piédestal. »

Cousin Thân (écrivain Nguyễn Quang Thân), photo de François May
À l’entendre parler avec cette fièvre dans la voix et le regard, je dois faire une drôle d’expression, car elle me dit en riant : « Ne fais pas cette tête-là, je suis une “fille moderne”, je connais le sens de l’Histoire et de la Justice, même si parfois je me laisse aller à évoquer la douceur de vivre d’un monde condamné. Je sais même ce que tu as en ce moment dans la petite tête d’Occidental : tu me compares à Scarlett O’Hara pleurant sur les beautés perdues de Tara. Hein ? Avoue-le ! Eh bien, je l’ai là, ton livre (incroyable mais vrai,elle me montre dans son bagage à main un exemplaire défraîchi d’Autant en emporte le vent), je mets un point d’honneur à l’emporter chaque fois que je vais à Hương Sơn. J’estime que nous nous sommes mieux débrouillés que Scarlett : nous nous sommes débarrassés de Tara. » Elle est terrible, ma cousine de Hương Sơn.
Il est presque midi, et le car ne part toujours pas. Les passagers déjà installés sont véritablement prisonniers du véhicule, n’osant pas bouger sous le coup d’une triple menace : donner l’impression que le car n’est pas assez rempli ; perdre leur place ; perdre leurs bagages. Alors ils restent là sagement, bougons mais assis. Heureusement qu’on est en hiver. Qu’est-ce que ce serait sous le soleil, en plein été ! Le chauffeur brillant par son absence, les mauvaises langues se déchaînent contre lui :
« Il doit être en train de cuver son vin quelque part.
Il n’a qu’à démarrer, on recueillera certainement des passagers sur la route.
De toute façon, même si le car est plein, il prendra des passagers en chemin, ça lui arrondira ses fins de mois.
Il est peut-être en train d’écouler au marché noir les billets du prochain voyage.
Et si l’on se cotisait pour acheter les billets restants ? Le car sera bien obligé de partir, plein ou pas plein. »
Cette dernière suggestion tombe à plat. Quelqu’un qui a déjà fait le voyage le mois dernier signale que le car partira quand le nombre de passagers atteindra quarante.
« Mais nous sommes déjà quarante ! Que quelqu’un aille voir au guichet ! »
Un bộ đội plus courageux que les autres se dévoue. Il revient anéanti :
« “On” m’a dit que le nouveau quorum est de cinquante passagers ! Camarades, si nous y allions tous en délégation, cela “les” obligerait peut-être à faire partir le car. » Personne ne bouge. Écœuré, le bộ đội lâche : « Puisque c’est comme ça, j’abandonne. Je vais essayer de me faire rembourser mon billet. »
Aussitôt c’est le tollé. La foule s’écrie, unanime :
« Ah, non ! Restez là, on a déjà assez de mal à faire le nombre, alors pas de désertion, hein ! »
Finalement, il est presque une heure et nous sommes presque cinquante quand le chauffeur s’amène, hilare. Il a bien mangé et bien bu, et nous avons le ventre creux.
« Allez, les enfants ! On embarque les bicyclettes ! »
Là, ça devient sérieux. Si l’on embarque les bicyclettes, le départ est assuré. On attache les précieux vélocipèdes (dont les deux nôtres) sur le toit du car. Tout le monde se cale, comme pour le décollage d’un avion. C’est parti !
Nous prenons la grande avenue rectiligne qui traverse tout Vinh. La ville autrefois rasée a été entièrement reconstruite suivant un schéma moderne, quadrillage de rues se coupant à angle droit. Disons reconstruite à moitié, car des immeubles neufs voisinent encore avec des chantiers qui, curieusement, ont l’air abandonné. Personne n’y travaille. Les fondations recueillent l’eau de pluie, et les murs de briques à moitié montés se couvrent d’une épaisse mousse noire. Comme je m’en étonne auprès de Nhân : « Manque de ciment, de briques, d’argent, me dit-elle. Et puis, si l’on entrepose des matériaux sur les chantiers, ils — euh — disparaissent, alors… »
À la sortie de la ville, un pont flottant — visiblement une construction militaire, du provisoire qui dure — traverse la rivière, d’une largeur considérable si près de son embouchure. C’est le port de Bến Thuỷ, qui rassemble toutes les industries de Vinh.
« Tout le monde descend et traverse à pied ! » crie le conducteur. Nhân refuse farouchement : « Je connais le coup, me dit-elle. Il y a des petits malins qui se mettent à l’entrée du pont, ils n’attendent qu’une chose, c’est que tu descendes pour monter squatter ta place. » Plus accommodant qu’elle, je m’exécute et traverse le pont en marchant à côté du car, dont les pneus font résonner la ferraille des flotteurs.
Après Bến Thuỷ, la route joue à cache-cache avec la rivière qui arrose les deux provinces du Nghệ Tĩnh : c’est le Sông Cả, qui devient le Sông Lam en passant d’une province à l’autre, si bien, m’a dit Nhân, qu’à un endroit précis on peut se baigner à la fois dans l’eau de deux fleuves. En s’éloignant de Vinh, on a l’impression de pénétrer de plain-pied dans une peinture sur soie, une peinture qui unirait idéalement les quatre composantes du paysage vietnamien : la rizière, la montagne, l’eau, le ciel. Rien n’y manque, ni le petit gardien de buffles au pas sur le sommet d’une digue, ni les jonques ventrues aux voiles violettes, nervurées comme des feuilles, ni l’envol des hérons, comme une bourrasque blanche jetée vers le bleu lointain des montagnes. Au bout d’un moment, à la lisière des nuages et de l’eau, perdu entre deux mondes incertains, on ne sait plus vers quel infini l’on a envie de voguer : la laque chatoyante du ciel, le frémissement de la rivière, ou le damier des rizières — un damier dont chaque case déclinerait une nuance du vert.
Le car nous lâche, Nhân, nos bicyclettes et moi, à l’embarcadère d’un bac. Hương Sơn se trouve sur l’autre rive. En fait de bac, ce sont deux jonques qui font alternativement la traversée. Chaque passeur propulse sa barque et ses passagers en poussant de toutes ses forces sur une longue gaffe prenant appui sur le fond de la rivière. Sur fond de montagne et d’eau, il ne manque pas d’allure, ce grand élan diagonal qui, à chaque poussée, semble vouloir propulser l’homme au bout de sa perche à l’assaut du ciel.
Tout en ahanant, notre passeur nous donne les nouvelles du jour. Aujourd’hui, il n’est question que de “la Française”. Depuis un bout de chemin déjà, je n’entends parler que d’elle : c’est la femme d’un vieil ONSiv (en vietnamien, lính thợ, c’est-à-dire soldat ouvrier) qui a tenu absolument à visiter le village natal de son mari. Elle vit à Hương Sơn depuis près d’un mois, partageant bravement l’existence des paysans, couchant à la dure et pataugeant dans la boue. Aujourd’hui, c’est justement le jour de son départ. Depuis ce matin, elle et son mari attendent la voiture du Bureau du Tourisme qui était censée venir les chercher. Normal. Le batelier nous indique une cahute sur la rive, assiégée par une armée de gosses curieux : « Tenez, ils se reposent là-bas en attendant… Quand même, il lui en a fallu, du courage ! Elle a dit à son mari : Je savais que vous étiez pauvres, mais pas à ce point ! » Holà, oh ! Il en rajoute, notre passeur.
Du débarcadère au village proprement dit, il y a encore quelques kilomètres par un sentier où nous nous engageons bravement à bicyclette. « Quelle chance qu’il fasse beau ! se réjouit Nhân. Par temps de pluie, c’est absolument impraticable. »
Paradoxalement, je passe totalement inaperçu parmi les “indigènes”, jusqu’à ce que j’ouvre la bouche, bien entendu, car alors mon accent me trahit. Alors que Nhân, avec son chemisier multicolore et ses cheveux courts (la dernière mode à Hanoi) attire partout l’attention, suscitant sur son sillage les sifflets et les appels insolents des garçons.
« Ça en fait deux, de “Françaises”, aujourd’hui », dis-je pour la taquiner.
Les cathédrales de Brooklyn
Nous arrivons enfin chez cô Lục (cô = tante cadette). C’est au bord d’un ancien arroyo, maintenant transformé en rizière. Sur la berge, de petites maisons se blottissent dans leur verger, derrière des haies impénétrables. Quand le vent secoue les bosquets de bambous, en fermant les yeux, on croirait entendre des navires hissant les voiles vers le grand large.
Curieusement, cô Lục, qui n’a jamais quitté Huong Son, est passée sans dommage aucun à travers toutes les tourmentes de la réforme agraire. Sa maison est même la seule de la famille qui soit restée pratiquement en l’état car, m’explique Nhân, elle l’a reçue en héritage avec le verger, mais sans les champs (de l’avantage d’être cadette), ce qui lui a permis d’échapper à l’étiquette de “propriétaire foncier” et du même coup aux excès de la réforme. Encore maintenant, avec son élégant toit de tuiles relevé aux quatre coins, ses piliers ronds en teck massif, l’enceinte de briques qui surélève et protège ses fondations, la petite maison garde un cachet splendide, qui donne une idée de ce que devaient être les demeures des riches d’autrefois. Pour moi en tout cas, qui depuis des semaines patauge dans la froidure et le crachin de Hanoi, il s’agit d’une halte bienvenue.
« Fatigué, moi ? Jamais ! » C’est pour avoir fait à cô Lục cette réponse pleine de panache que me voici en train de traîner les pieds derrière elle, avec Nhân, à travers tout le village de Hương Sơn. Mais au fond je ne suis pas mécontent, car nous sommes par une de ces journées transparentes où la limpidité de l’air, la profondeur du ciel, le frémissement du vent, jusqu’à la qualité de la lumière, tout concourt à créer, au plus profond de nous-mêmes, comme une impression de miracle.
Tout en marchant, cô Lục n’arrête pas de louer ma bonne fortune météorologique :
« D’habitude il pleut en cette saison. Il faut alors voir la boue, la gadoue… On enfonce jusqu’aux mollets et l’on perd ses sandales. Dans certains villages très riches, comme Ninh Bình, plus au nord, les sentiers étaient pavés de briques, résultat d’une vieille coutume qui voulait qu’à chaque mariage, le nouvel époux fît don à la communauté de la quantité de briques nécessaire pour couvrir le chemin de sa demeure à celle de sa femme. »
Nous
marchons, Nhân et moi, dans les allées ocellées de soleil, et cô
Lục nous guide, mais c’est à travers les méandres de sa
mémoire. Le moindre sentier, le moindre bosquet, le moindre champ
lui parlent chacun son langage secret que nous n’entendons point,
et même quand nous l’entendons, nous ne le comprenons pas, tant le
monde insouciant et la jeune fille qu’ils évoquent diffèrent du
monde d’aujourd’hui et de la femme aux cheveux blancs, aux traits
burinés, qui le traverse d’un pas lent. Pourtant c’est merveille
de l’entendre égrener ses souvenirs, comme des fleurs fanées
échappées d’entre les pages de la mémoire : « Tiens,
ce champ… Je me souviens que cette année-là, quand on l’a
asséché, je suis allée avec d’autres attraper les poissons qui
se cachaient dans la boue. J’étais déjà engagée officieusement
avec l’oncle Lục (qui est originaire de Ninh Bình), aussi, à
chaque fois que je pêchais un poisson, les gens debout sur la
diguette s’écriaient tous en chœur : “Celle de Ninh Bình
en a pris un gros !” »
Elle ajoute, en se tournant vers moi : « À propos de pêche, ton père était un fanatique, un vrai de vrai. Il pouvait passer des journées entières à patauger dans les rizières… Je garde une image de lui, le pantalon retroussé, plongé dans la boue, un poisson dans chaque main et un troisième entre les dents ! Aujourd’hui encore, après tant et tant d’années, je revois le soleil étincelant sur les gouttes d’eau, sur les écailles grises et sur le ventre blanc, comme si le poisson souriait pour ton père. »
Nostalgie, nostalgie… Je repense aux propos de Nhân que, coïncidence ou accord profond, cô Lục démarque sans le savoir, dans son évocation d’un monde révolu, refermé sur lui-même et sur ses privilèges. Mais était-il vraiment si fermé ? En France, avant mon départ, on m’avait prévenu charitablement : « Tu verras, là-bas dans ce coin du Nghệ Tĩnh, ce sont les pires bolcheviks de la terre. Ils ne pensent qu’à une chose : couper toutes les têtes qui dépassent du rang. »
Ce n’est pas tout à fait ce que dit cô Lục : « Au fond, les gens d’ici sont de grands sentimentaux. Par exemple, tout le monde dans le village garde le souvenir de ton père, mais… comment dire… d’une façon extravagante. Quand il est parti faire ses études et qu’il s’est retrouvé coincé là-bas dans le Sud, des rumeurs folles ont couru à son sujet. Au bout d’un certain temps, c’était même devenu un personnage mystérieux, mythique, à qui l’on attribuait tous les phénomènes inexpliqués qui survenaient dans le coin. Ainsi pour “les sandales près du puits”… En sortant du village, sur le chemin qui mène à Vinh en passant par les collines, il y a un vieux puits dont on ne sait plus qui l’a creusé ni à qui il appartient. Enfants, nous jouions dans les parages, dans ce qui pour nous était un pays de génies et de fantômes, de grottes et de rochers, et le puits nous semblait un passage vers des abîmes insondables… Quelques années après le départ de ton père, on a retrouvé sur la margelle du puits une paire de sandales, comme si quelqu’un les avait posées là pour se laver les pieds, puis les avait oubliées en partant. Aussitôt, dans le village, on a chuchoté que ton père était revenu, que les sandales étaient les siennes, qu’il se cachait dans les collines, qu’il en descendait la nuit pour aller voir sa famille…
« Les plus romanesques allaient jusqu’à dire qu’il avait rangé ses chaussures sur la margelle avant de se jeter dans le puits. Tu vois, conclut cô Lục, ce sont des sentimentaux. »
Justement,
nous croisons un de ces sentimentaux sur un “pont de singe” qui
enjambe un arroyo. C’est tout juste s’il ne tombe pas à l’eau
quand cô Lục fait les présentations. Après s’être exclamé
plusieurs fois trời ơi ! (juste ciel !), il décide de
nous accompagner un bout de chemin. Pendant que cô Lục et lui
évoquent le bon vieux temps (en ce qui les concerne, c’était
plutôt le mauvais vieux temps), Nhân me dit en aparté :
« Il faut que je te parle de ce vieux bonhomme (ông lão). Enfant, Thân était assez malingre et sujet à de fréquents évanouissements. Cela inquiétait beaucoup notre grand-mère [une vraie matriarche, le véritable chef du clan !], car c’était Thân l’héritier du nom [cháu đích tôn, textuellement : le fils aîné du premier fils]. Rien n’était donc trop bon pour le “petit monsieur”. Il portait autour du cou une petite racine de ginseng rouge, à mâcher pour quand il tombait dans les pommes ; et pour qu’il ne risque pas de se noyer en allant à l’école, grand-mère avait fait construire ici même un pont, un véritable pont avec des piliers et des planches en bois de teck, tu te rends compte ! Bref, après la Révolution, les paysans du coin se sont partagé le bois, et ce vieux bonhomme n’était pas le dernier… Attends, ce n’est pas fini. Il y a quelques années, un détachement de l’Armée populaire est passé ici, avec matériel et tout. Pluie, boue, arroyo infranchissable. Que crois-tu que fit notre vieux ? Il donna son litv pour servir de pont aux soldats.
Oui, dis-je, ce sont des sentimentaux. »
Nous approchons maintenant du but de notre voyage, ou plutôt de mon voyage, car je suis venu essentiellement pour cela. C’est sur un faux-plat, au flanc d’une colline qui continue à monter sur notre gauche. Un banian régnait là, dont il ne reste que des chicots, comme des verrues boursouflées. Dominant la plaine, dans un isolement ostentatoire, trois tombes. Les deux anciennes sont celles des grands-parents de la famille, la troisième, plus récente, est celle de chú Quýnh, l’oncle cadet. L’histoire de chú Quýnh, c’est à la fois le résumé d’une génération et une tragédie personnelle. Rescapé de la réforme agraire, engagé dans l’Armée populaire, puis officier des transmissions, il avait fait toute la guerre de résistance contre les Américains. Dans les premiers mois de l’année 75, il était “planqué” avec son unité tout près de Saigon, quelques dizaines de kilomètres, une misère. Jamais il n’avait été aussi proche de son frère, mais c’était comme si les séparait toute l’étendue de la Cordillère. Et puis, le dernier jour, il était entré dans la ville. À un carrefour, un camion l’avait renversé. Les mots manquent pour dire l’injustice d’une telle destinée.
Dans le vent froid qui souffle en plein soleil, cô Lục allume avec quelques difficultés des bâtonnets d’encens avant de faire sur les tombes les prosternations d’usage. Dans le silence de la montagne, sa voix s’élève, elle parle aux morts en la présence des vivants. En cet après-midi du vingtième siècle, à trente kilomètres et quelques de la civilisation industrielle, cela me fait un drôle d’effet de l’entendre s’adresser à ses parents et à son frère comme s’ils étaient là, assis devant elle, et qu’elle s’avance pour leur présenter le neveu lointain qui vient les voir par delà les mers. Nhân pleure sans vergogne. Je pense à toutes les choses qui devaient être dites, et qui ne seront pas dites, parce que la séparation est une mort, et la mort, une trahison. J’ai les yeux secs, mais m’écrase le fardeau invisible dont malgré moi je suis le porteur : souvenirs par procuration, retrouvailles par délégation, ambassade des espérances…
La cérémonie finie, nous redescendons la colline pour entamer la tournée rituelle des visites. Le téléphone de brousse a dû fonctionner, comme dans le cas de “la Française”, car sur mon passage, voisins proches et lointains s’invitent pour venir me voir. À peine suis-je installé quelque part pour le thé traditionnel que le voisin vient “faire un tour” (à moins qu’il ne soit déjà sur place !), puis c’est toute la famille du voisin, puis bientôt les amis du voisin, puis la famille des amis… Et le passé de ressusciter, et les questions de fuser, et le thé de couler pour fêter le retour de l’enfant prodigue. “Retour” car ils me considèrent bel et bien comme l’un des leurs, ces villageois sentimentaux, comme si en ma personne ils fêtaient mon père, comme si, par-dessus les excès d’hier et les injustices d’avant-hier, les souvenirs jetaient un pont reliant directement le jeune homme d’autrefois au jeune homme d’aujourd’hui. Ceux de la nouvelle génération m’interrogent, les yeux brillants, sur la vie dans les pays de la vieille Europe. Ceux de l’ancienne génération, riant dans leur barbiche, rassemblent leurs souvenirs de géographie pour faire du tourisme à travers mes récits.
Les ombres du soir s’allongent quand nous rentrons chez cô Lục, complètement sur les rotules. Surprise, qui voyons-nous devant la maison, pataugeant dans l’étang, le pantalon retroussé, la cigarette au bec, une épuisette à la main pour pêcher les crevettes ?
« Un instant, dit cô Luc, j’ai cru voir… »
C’est le cousin Thân en personne, venu de sa lointaine Hải Phòng. Comme à son habitude, il a “chiadé les correspondances”.
« De Hải Phòng à Hà Nội, nous dit-il, j’ai fait l’ancienne route coloniale en mobylette. Une vieille mobylette bien française, s’il vous plaît, pas une de ces fringantes Honda sur lesquelles paradent les jeunes d’aujourd’hui. De Hà Nội à Vinh, je me suis fait convoyer dans la camionnette qui va distribuer chaque jour le Nhân Dân dans les villes de province. J’en ai profité pour lire le journal ! Et de Vinh à Hương Sơn, j’ai pédalé bravement à bicyclette au sommet de la digue qui longe la rivière… »
Il tient absolument à nous expliquer pourquoi nous l’avons surpris à la pêche aux crevettes : « Il y a une semaine, j’ai envoyé un télégramme à Vinh : Neveu français arrive (celui-là, ils l’ont bien reçu). La veille de mon départ, j’ai re-télégraphié : Préparer chien. L’employé des postes a protesté : Qu’est-ce que c’est que ce charabia ? Je l’ai prié de s’occuper de ses affaires. En arrivant à Vinh, j’ai vu le chien noir qui gambadait dans la cour, comme si de rien n’était : j’avais dépassé mon télégramme ! C’est pourquoi me voici en train de pêcher pour améliorer l’ordinaire. » Il ajoute :
« Cette nuit, je passerai à la production (sản xuất) en grand, avec une lampe-torche.
Il parle des grenouilles », me souffle Nhân.
La nuit a effacé ses moindres reflets. Au dehors, l’aube ne va pas tarder à blanchir le ciel et pourtant ici, dans la pièce noyée d’ombres, impossible de trouver le sommeil, après une journée si particulière. Et une soirée si singulière. Nous avions veillé tard, en compagnie d’amis et de voisins qui ne se résignaient pas à partir. Le papillotement des lampes à pétrole, l’odeur du feu de bois, la fumée des pipes à eau, tout se conjuguait pour nous plonger dans une torpeur silencieuse. On n’entendait que les grognements béats d’un porcelet noir et rose qui se pelotonnait contre le foyer — preuve d’une longue habitude — sans crainte aucune des braises.
Thân finit par dire : « Qu’il se pousse encore un peu plus dans le feu, et nous aurons du cochon rôti. »
Cela me rappela une histoire drôle, mais authentique. À propos de cochon, voici ce qui est arrivé à un Việt kiều de Paris. C’était à l’époque où le Cambodge faisait la une des quotidiens. En allant acheter son canard au kiosque habituel, notre ami s’entend dire par le marchand de journaux :
« Alors, il paraît que vous affamez les Cambodgiens ? C’est le R. P. Ponchaud qui l’affirme, depuis que vous êtes chez eux, vous leur bouffez même leurs chiens. »
Sans se démonter, notre Việt kiều rétorque :
« Eh oui, chez nous, on élève les cabots en batterie, mais même cela ne suffit pas à la demande ! Mais dites-moi, vous les Français, vous avez l’habitude répugnante de manger un certain animal…
Vous parlez des grenouilles ?
Les grenouilles ? Ciel, non ! Vous avez déjà vu une grenouille garder la maison ? Vous tenir compagnie au coin du feu ? Vous lécher la main en cas de déprime ? Non monsieur, je parle du meilleur ami de l’homme, le cochon. »
Hilarité générale. Cela parut mettre Thân en verve :
« J’ai une histoire aussi à raconter. C’est moins drôle, mais plus personnel. C’était au temps où j’étais radio amateur… »
Sentant qu’il avait réussi à
capter l’attention de son auditoire, il prit le temps de se caler
confortablement et de tirer quelques bouffées. Aveuglés par
l’obscurité, nous fixions fascinés le brasillement syncopé de sa
pipe à eau — la lumière intermittente faisait sortir son visage
de l’ombre, comme une tête sans tronc.
« C’était pendant l’été de 1968. L’offensive du Tết Mậu Thân, au printemps, avait soulevé dans le pays un élan indescriptible. Personnellement, j’étais dans un état d’exaltation permanente, je pensais (et je n’étais certainement pas le seul) que la fin était proche, que le rêve d’une génération allait prendre corps. Puis le printemps passa, et vint l’été. Quelle déprime ! Vue le loin, la machine de guerre américaine paraissait toujours aussi formidable — et la forteresse de Saigon, imprenable. J’étais à Vinh à cette époque. Le vent du Laos (gió Lào) soufflait de la Cordillère, desséchant les corps et les esprits. Ce soir-là, il s’était particulièrement déchaîné ; par moments, on se serait cru dans la gueule d’un réacteur d’avion. J’étais grimpé sur le toit pour chercher un peu de fraîcheur (quand souffle ce maudit vent, on n’a même plus peur des moustiques). Le ciel entier tremblait de chaleur et les étoiles palpitaient, des étoiles énormes, grosses comme des pavots. Au bout d’un moment, j’ai dû m’hypnotiser moi-même en les regardant, car elles me semblaient tourner sur leur erre et tomber vers moi, ou moi vers elles, et ce n’était plus le toit de la maison que je sentais sous mon dos, mais la dure rotondité de la Terre — j’étais une mouche collée sur un boulet de canon qui fonçait dans l’espace… Tout ça pour vous dire dans quelles transes, dans quel état second j’étais quand me vint mon idée. L’attente de toutes ces années, concentrée dans l’espoir de ce printemps, consumée dans la fournaise de cet été… J’eus tout à coup le besoin physique de savoir. Je voulais savoir ce qui se passait là-bas dans le Sud. Entendre à défaut de voir. J’eus l’idée de me fabriquer un poste de radio… »
Thân
fit une pause théâtrale. Comme il ne tirait plus sur sa pipe, nous
ne distinguions plus de lui, dans la lueur mourante des lampes, qu’un
profil d’ombre d’où sortait la voix du passé — la voix de cet
été 68.
« Il me fallut trois mois pleins pour aller au bout de mon projet. Je partais… de rien. Je n’avais aucune connaissance, aucun matériel, aucune expérience. Rien. Je devins un rat des bibliothèques scientifiques. Je devins une mite rongeant les schémas d’électronique. Je devins une sangsue pour mes amis, mes connaissances, tous ceux qui travaillaient dans le domaine technique : je leur suçais leur temps, leur énergie, leur savoir. Pour leur sauvegarde comme pour la mienne, il vaut mieux ne pas révéler comment je me suis procuré, une à une, les pièces nécessaires. J’appris à souder. J’appris à bobiner, embobiner, rembobiner. Je fis cent métiers plus un… Enfin vint le grand soir. Je m’installai dans le verger, derrière la maison, sous mon jaquier préféré. Je mis le contact, et ce fut comme si je lançais une sonde dans l’éther. Mon potentiomètre n’étant pas étalonné, j’étais comme un pêcheur lançant ses filets au hasard pour ramener des bouteilles jetées à la mer.
« Bande après bande, fréquence après fréquence, j’explorais les spectres. Pendant ce qui me parut une éternité, je ne recueillis que des grésillements, des crachotements, des bourdonnements — c’était le murmure des électrons, ou les voix du silence… Imaginez ma frustration : j’avais mis trois mois à bricoler un appareillage qui ne me permettait même pas de capter la radio de Vinh ! La tête en feu et les doigts engourdis, je m’obstinais, en bon natif du Nghệ Tĩnh… Enfin je perçus un soupir, puis un murmure, puis une voix — une voix ô combien lointaine, comme si elle venait d’un autre monde. Encore aujourd’hui, je ne sais pas sur quelle émission j’étais tombé. Probablement la BBC ou la Voix de l’Amérique, car c’était en anglais. J’entendais la moitié des mots, je devinais la moitié des phrases. Un éditorialiste célèbre parlait. Il s’appelait Walter quelque chosevi. Il disait en substance : “J’ai beaucoup de sympathie pour le peuple vietnamien, car je comprends l’objectif de sa lutte. Or voici deux frères, élevés dans la même famille mais dont les chemins dans la vie se sont séparés. L’un est allé, des dollars plein les poches, se dévergonder sur les trottoirs de Brooklyn. L’autre est revenu des cathédrales du marxisme, brandissant les livres saints. Où est le vice, où est la vertu ? Je ne sais. Ce que je sais, c’est que ce ne sont plus deux frères, mais deux étrangers — si étrangers l’un à l’autre qu’ils ne pourraient vivre sous le même toit. C’est pourquoi je suis triste pour le peuple vietnamien, car il se bat pour une chose insensée : des cathédrales à Brooklyn.” Oh ! cette voix d’outre-tombe ! Elle pénétrait en moi, elle me remplissait de sa certitude. Vrai, c’était bien un rêve insensé. Je crois que j’ai pleuré, seul au pied de mon jaquier. »
Thân avait parlé d’une traite. Sa pipe s’était éteinte. Il la ralluma avec des gestes lents et minutieux : « Et puis te voici, toi le cousin étranger. Je ne connaissais pas du tout ton visage. J’avais oublié celui de ton père. Qui l’eût dit ? Tu as vu ce pays du Nord jusqu’au Sud. Tu es revenu au village de tes origines. Tu as accompli un devoir longtemps différé. Nous nous sommes assis à la même table, avec les parents, les amis, les voisins. Nous avons parlé d’hier et d’aujourd’hui. Nous avons plaisanté sur les chiens, les grenouilles, les cochons. Et les cathédrales de Brooklyn… peut-être sommes-nous en train de les bâtir ? »
À l’approche du matin, j’ai fini par tomber dans une somnolence agitée. Les images de la journée tournaient dans un lent kaléidoscope. Je revois les tombes sur la colline, les sandales sur la margelle du puits… Le cousin Thân est dehors, en train de faire la guerre aux grenouilles, mais dans un demi-rêve éveillé, je le vois marchant le long des vagues, une épuisette à la main pour recueillir les bouteilles jetées à la mer… Dans une sorte de projection sur le futur immédiat, comme cela arrive souvent entre veille et sommeil, je me vois me lever, ouvrir la porte, aller à sa rencontre : « Allons, encore un effort, lui dis-je, demain est un autre jour. Nous avons attendu si fort, pendant si longtemps, que maintenant tout nous est promis. »
Nguyễn Quang
i Articles
parus
dans Doan Ket (n°376-378, janvier-mars 1986) signés sous le pseudonyme
Z.T.
ii Le mot quê désigne en effet, non pas la “terre natale” (le lieu de naissance), mais la “terre ancestrale” (le lieu de naissance du père).
iii Hương Sơn signifie littéralement « Montagne parfumée ».
iv Les ONS sont des ouvriers non spécialisés, recrutés plus ou moins de force par les Français lors des deux dernières guerres mondiales.
v Traditionnellement, les Vietnamiens dorment sur des planches de bois.
vi Il s’agissait probablement de Walter Conkrite ou de Walter Lippman.
Các thao tác trên Tài liệu