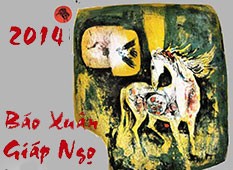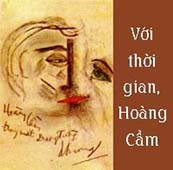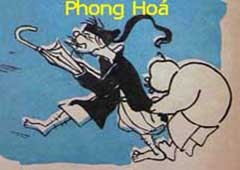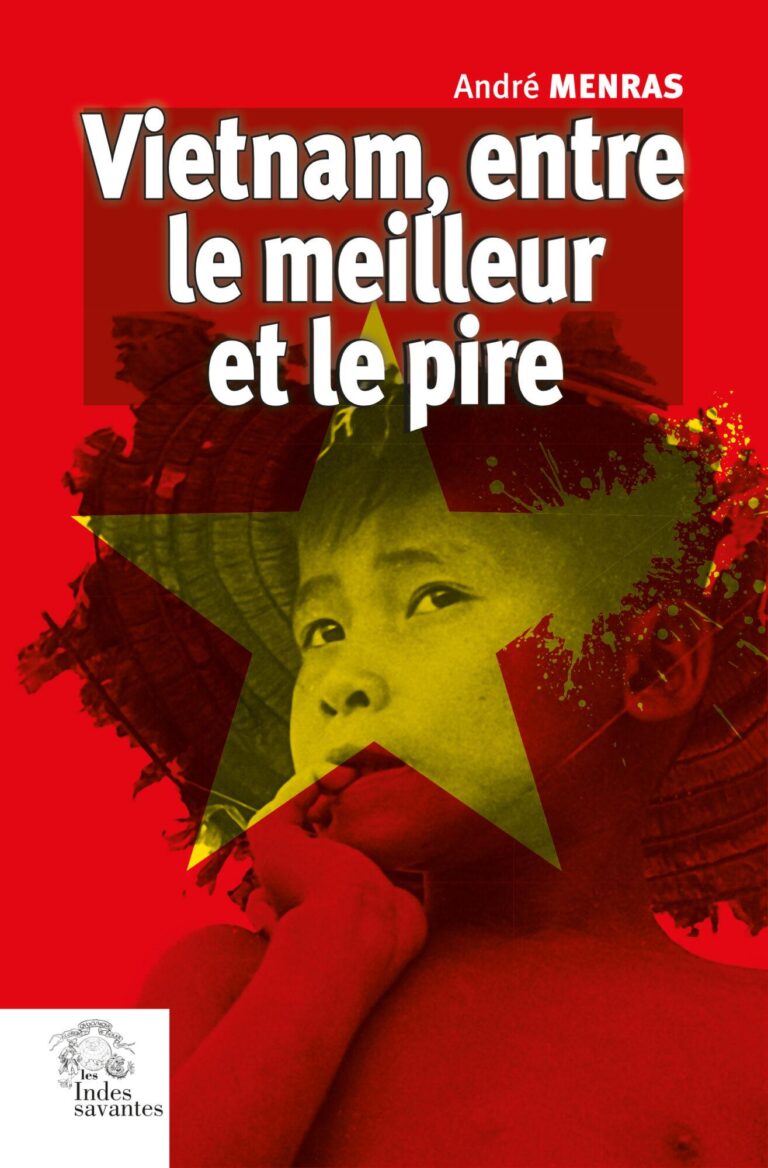En attendant qu'il "dégage"...
Entre
deux tours
En attendant qu'il "dégage"…
Nguyễn Quang
Hollande
28,63%, Sarkozy 27,06%. Jamais dans l'histoire de la 5ème
République un président sortant n'est arrivé en seconde position
au premier tour. Et des sondages de sortie des urnes qui le donnent
invariablement perdant au final à 46 contre 54. Est-ce à dire que
les jeux sont faits ? Au-delà des positions prises par l'un ou
l'autre camp, et qui sont surtout des postures à l'intention
de l'électorat, essayons de lire dans les cartes (sans jeu de mots).
Du point de vue strictement arithmétique, Sarkozy n'est pas en si
mauvaise posture après tout. Malgré la crise économique, malgré
la crise de confiance, dans une Europe qui jusqu'ici a
systématiquement "sorti les sortants", le
président-candidat arrive seulement 500 000 voix derrière son rival
socialiste. Mieux, en amalgamant sans ambage les voix de la droite,
de l'extrême-droite, des divers droite et des "souverainistes",
le Figaro et le patron de l'UMP réclament plus de 45% des électeurs,
contre moins de 44% à l'ensemble des gauches et des écologistes.
Alors, pour reprendre les "éléments de langage" du camp
sarkozyste, est-ce une nouvelle campagne qui commence ? On ne le
pense pas, et pour plusieurs raisons :
* les élections ne
sont pas une science exacte, mais toutes les expériences passées
montrent que le premier tour détermine le second. Ainsi en 2007,
avec une avance de près de 5 points au premier tour
et des sondages à 52% en sa faveur pour le second, Sarkozy lui-même
considérait l'affaire comme "pliée" à la mi-temps. On
nous objectera que cette fois l'écart (réel) au premier tour est
faible, et que l'écart (projeté) pour le second, aussi énorme
soit-il, est seulement un sondage. Voire. On a l'habitude de dire
qu'un sondage ne donne qu'une photographie instantanée d'une
situation évolutive, mais cent sondages sur plusieurs mois qui
donnent toujours des résultats analogues, c'est un tableau qui
s'installe dans la durée. Les chiffres du premier tour pouvaient
monter ou descendre suivant les péripéties de la campagne, le
sortant n'arrivait pas à décrocher son challenger, comme on dit en
cyclisme. Et au second tour, c'était lui qui était lâché,
toujours avec un écart de 6 à 8 points. De sorte que, fin 2011, le
président-candidat en était arrivé à admettre que dans une telle
configuration, il partait battu en 2012. Il ne faut pas chercher
ailleurs la "dérive droitière" de sa campagne, qui
n'était pas une dérive, mais une stratégie délibérée visant à
braconner sur les terres du populisme de droite les voix qu'il ne
trouvait plus au centre. Connaissant le personnage, on peut penser
qu'il ne s'agit aucunement d'une improvisation, mais d'une stratégie
sciemment pensée, de s'emparer de problèmes sociétaux -- le
chômage, la pauvreté, l'insécurité -- pour en faire des thèmes
clivants, jouant sur les peurs (crises, délinquance, terrorisme),
dressant les unes contre les autres des catégories
socio-professionnelles (travailleurs contre retraités, commerçants
contre fonctionnaires, syndicats contre patronat), stigmatisant des
populations entières (chômeurs assimilés à des profiteurs,
assistés à un "cancer", immigrés à des délinquants,
musulmans à des terroristes). Cette conversion thématique du
candidat, le président devait la préparer depuis des années, comme
en témoigne le tristement fameux discours de Grenoble de juillet
2010 où, profitant d'un fait divers (des émeutes violentes de gens
du voyage après la mort de l'un des leurs, tué à un contrôle
routier), il pointe du doigt l'ensemble des Roms et invente une
catégorie inédite de "citoyens d'origine étrangère" à
qui la nationalité française devrait être retirée en cas de
meurtre d'un dépositaire de l'autorité publique. Il faut remonter
aux heures sombres de Vichy pour voir les plus hautes instances de
l'Etat mettre ainsi en accusation des communautés entières.
Le but clairement énoncé par Sarkozy, sa dernière chance même,
selon les éléments de langage de son équipe, c'était de virer en
tête au premier tour pour profiter d'une dynamique qui lui aurait
permis de remonter le handicap promis par les sondages au second.
Mettant le cap "à droite toute", martelant les "valeurs"
et "l'identité nationale", profitant du choc des meurtres
terroristes de Montauban et de Toulouse, il a connu une "séquence
favorable" qui a pu semer quelques inquiétudes chez ses
opposants. Mais l'amateurisme confondant de sa campagne, ses zigzags
incessants, ses contradictions flagrantes, l'insignifiance de ses
mesurettes, la dévaluation de sa parole, tout cela a fait qu'une
fois l'émotion retombée, "les courbes ne se sont pas
croisées", pour parler comme les sondeurs.
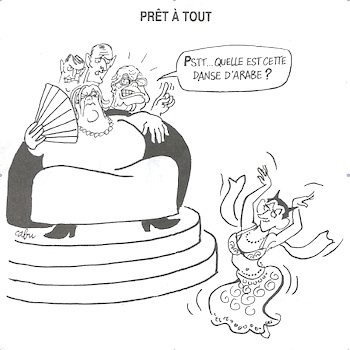
* le succès
de François Hollande au premier tour vaut donc moins par son avance
que par l'échec de la stratégie sarkozyste. Avec ses 27%, le
président sortant a perdu 4 points par rapport à son score de 2007,
et il a probablement raclé les fonds de tiroir de la droite. Le
parti UMP au pouvoir a absorbé le centre droit (l'ancienne UDF de
Giscard). Le "vrai centre" de François Bayrou se partage
d'habitude équitablement en trois au second tour (1/3 pour la
droite, 1/3 pour la gauche, 1/3 pour l'abstention), et d'ailleurs ses
9,10% ne lui permettent plus de jouer les faiseurs de roi. Ce rôle
est désormais dévolu au parti de Marine Le Pen, avec son score
record de 18%. Le succès du FN en France s'inscrit dans un mouvement
de fond qui a vu le surgissement, porté par les crises successives,
de mouvements populistes de plus en plus…populaires: dans les pays
du Nord (19% en Finlande, 23% en Norvège, 14% au Danemark, 15,5% aux
Pays-Bas), en Autriche (30%), en Suisse, en Italie du Nord… Leur
fond de commerce repose sur quelques thèmes forts et simples, dont
Sarkozy s'est emparé sans vergogne: le peuple contre les élites;
rejet du cosmopolitisme et de l'européanisation; dénonciation de
l'immigration incontrôlée, du multiculturalisme et de l'islam…
L'expert de la Fondation pour l'innovation politique (Fondapol),
Dominique Reynié, affine l'analyse en dévoilant "un populisme
patrimonial articulant deux formes de conservatisme de réaction:
d'un côté, la protection d'intérêts matériels comme le niveau de
vie et l'emploi, et de l'autre, un patrimoine immatériel,
c'est-à-dire l'attachement à un certain style de vie menacé par
l'immigration et la globalisation". Parmi ces mouvements, le FPO
autrichien et le FN français se distinguent en outre par leur
enracinement dans une extrême-droite se référant implicitement ou
explicitement à l'héritage des années 30 et à l'antisémitisme.
En France, l'électorat de Marine Le Pen n'est pas homogène, il
agrège à son noyau d'extrême-droite traditionnel des nouveaux
venus, ces victimes "invisibles" de la crise (artisans,
paysans, chômeurs) qui s'estiment oubliées des politiques. Une
première étude TNS-Sofres (24 avril) indique qu'au second tour, 29%
des électeurs FN s'abstiendront, 45% voteront Sarkozy et 26%
Hollande. Il est normal que les deux prétendants restants cherchent
à récupérer les voix qui leur manquent. Mais alors que le candidat
socialiste le fait sans oublier ses valeurs ni ses engagements (il a
ainsi courageusement maintenu son projet d'accorder aux étrangers le
droit de vote aux élections municipales), le président-candidat,
lui, s'est livré à une imitation du discours frontiste telle
qu'elle revient à faire sauter le "cordon sanitaire"
imposé il y a quinze ans par Jacques Chirac autour de la droite
extrême (aux dernières élections régionales, il avait déjà
refusé de respecter le "front républicain" face au FN).
Mais son indigne "danse du ventre" ne lui servira à rien
contre une réalité non plus seulement statistique, mais politique,
évidente : il est dans l'intérêt des dirigeants frontistes de
provoquer la défaite de Sarkozy à la présidentielle, puis celle de
l'UMP aux législatives, pour provoquer l'implosion de la droite et
prospérer sur ses décombres. En face, l'ensemble des gauches
faisant preuve d'une solidarité et d'une détermination
impressionnantes, avec près de 90% d'intentions de report sur le
candidat socialiste, tout conduit à penser que, sauf tremblement de
terre, il y aura alternance au soir du 6
mai.
NGUYỄN QUANG
>> version vietnamienne
Các thao tác trên Tài liệu